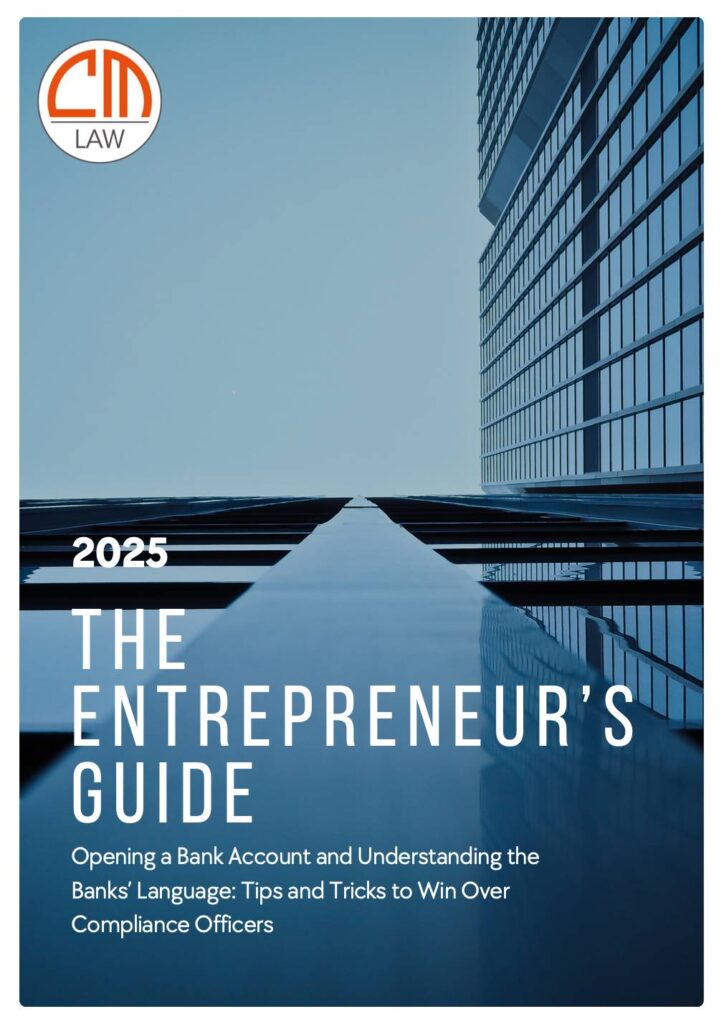Introduction – Quand une banque suisse met le feu au droit pénal luxembourgeois
Une affaire banale ? Pas tant que ça
À première vue, l’affaire jugée par la Cour d’appel de Luxembourg le 26 février 2025 pourrait passer pour un contentieux technique parmi d’autres dans le champ souvent discret de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT).
Tout y est : Une banque suisse, la succursale luxembourgeoise d’un établissement financier d’envergure, se voit reprocher des manquements aux obligations de vigilance imposées par la loi du 12 novembre 2004.
En 2020, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) lui inflige une sanction pécuniaire de 170.000 euros pour des violations constatées à l’issue d’un contrôle on-site.
Quelques années plus tard, le parquet décide d’engager des poursuites pénales sur les mêmes faits.
Classique ? En apparence oui, c’est une situation fréquente.
Néanmoins, ce qui semblait relever d’un simple dossier de conformité va en réalité conduire à une décision au retentissement bien plus large : La Cour d’appel considère que la poursuite pénale engagée est irrecevable, puisqu’une première sanction administrative a été infligée.
En somme, une application stricte du principe ne bis in idem… Alors que l’on parle d’une amende administrative, et tout particulièrement en LCB-FT, sujet hautement stratégique au Grand-Duché.
L’enjeu réel : le sort du double filet administratif et pénal
L’intérêt majeur de l’arrêt tient à la question centrale qu’il soulève : peut-on encore cumuler, dans le champ du droit pénal économique, une sanction administrative infligée par une autorité de surveillance sectorielle et une poursuite pénale engagée par le ministère public, lorsque les deux procédures concernent les mêmes faits ?
La réponse donnée par la Cour est claire, nette et précise : en l’absence d’un mécanisme formalisé de coordination entre les deux volets, ce cumul viole le principe ne bis in idem tel qu’interprété par le droit européen.
En d’autres termes, le Luxembourg ne peut pas à la fois laisser sa régulation administrative évoluer vers une répression quasi-pénale, et conserver une voie répressive autonome, sans organiser leur articulation.
Derrière cette affaire, c’est donc tout l’édifice institutionnel de la compliance qui est interrogé.
Elle met en lumière les tensions croissantes entre efficacité répressive, protection des droits fondamentaux et impératifs internationaux en matière de lutte contre la criminalité financière.
Une problématique à la croisée du droit européen et du droit pénal financier
Ce contentieux n’est pas isolé, ou spécifique à la place financière. Il dépasse en effet largement le cadre luxembourgeois, puisqu’il s’inscrit dans un mouvement plus vaste d’européanisation du droit pénal économique, où les lignes de partage entre sanction administrative, sanction pénale et sanction de régulation deviennent de plus en plus poreuses.
À travers les critères Engel , les arrêts A & B c. Norvège , Menci ou encore Grande Stevens c. Italie , la jurisprudence européenne a imposé des garde-fous au cumul des procédures, et la Cour d’appel luxembourgeoise s’en empare pleinement.
Le débat ne fait donc que commencer car cet arrêt pose une question redoutable :
Si l’on ne peut plus cumuler les voies de répression, comment garantir à la fois l’efficacité de la LCB-FT et le respect des droits fondamentaux ?
Et surtout :
Le Luxembourg est-il aujourd’hui équipé pour répondre à cette exigence d’articulation des pouvoirs répressifs ?
C’est à ces questions que cet article entend répondre, en revenant sur la décision du 26 février 2025, sa portée, sa comparaison avec les systèmes voisins et ses conséquences sur l’équilibre entre conformité et répression.
L’arrêt du 26 février 2025 : autopsie d’une irrecevabilité
La succursale d’une banque suisse sous un double viseur
Tout commence par un contrôle sectoriel mené entre mai et juin 2018 par la CSSF au sein de la succursale luxembourgeoise d’un établissement bancaire suisse.
Ce contrôle fait ressortir de graves lacunes dans la mise en œuvre des obligations de vigilance, de surveillance continue et d’analyse des opérations atypiques, telles que prévues par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après « la Loi de 2004 »).
Plus précisément, des manquements sont constatés à l’article 2-2 (dispositif de vigilance), à l’article 3 (analyse et classification des clients) et à l’article 5 (obligation de déclaration de soupçons).
Le 27 juillet 2020, la CSSF décide donc de sanctionner. Une amende administrative de 170 000 euros est prononcée.
Aucun recours n’est exercé contre cette décision, qui devient définitive.
Mais… quelques mois plus tard, le ministère public engage des poursuites pour les mêmes manquements, au visa de l’article 9 de la Loi de 2004, qui sanctionne pénalement ceux qui ont contrevenu « sciemment » aux obligations prévues aux articles précités.
L’établissement bancaire soulève alors adroitement une exception de procédure : cette poursuite pénale serait irrecevable au regard du principe ne bis in idem, puisque les faits ont déjà été sanctionnés, fût-ce par une autorité administrative.
Le débat est posé.
Le dilemme du cumul : punir deux fois ou respecter les droits fondamentaux ?
La question n’est pas nouvelle, mais elle revient ici avec une acuité particulière :
Peut-on, en l’absence de mécanisme explicite de coordination, sanctionner deux fois les mêmes faits sous des qualifications différentes ? Et surtout : la sanction infligée par la CSSF doit-elle être considérée comme « pénale », même si elle est prononcée par une autorité administrative dans le cadre d’un processus interne de régulation financière ?
Le ministère public tente de contourner l’obstacle :
Il soutient que la procédure administrative et la procédure pénale poursuivent des objectifs différents et que la sanction de la CSSF n’a pas un caractère pénal au sens de la jurisprudence européenne. Il invoque également l’intérêt général à lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux, y compris par la voie pénale.
Mais la défense réplique : La nature de la sanction CSSF, son montant, son objet et son effet dissuasif dépassent le cadre purement administratif.
La Cour va trancher en appliquant les grands principes dégagés par la jurisprudence Engel de la CEDH et réaffirmés dans les arrêts A & B c. Norvège et Menci.
L’analyse chirurgicale de la Cour : sanction pénale + absence de coordination = nullité
La motivation de la Cour est méthodique.
Elle commence par qualifier la sanction de la CSSF comme étant, nonobstant son apparence administrative, une sanction de nature pénale. Pour cela, elle applique les critères Engel :
- Nature de l’infraction : les obligations LCB-FT s’adressent de manière générale à tous les professionnels du secteur financier et relèvent de l’ordre public économique ;
- Nature et finalité de la sanction : la CSSF inflige une amende ayant une portée dissuasive et répressive, non purement préventive ou corrective ;
- Degré de sévérité de la sanction : bien que modérée (170.000 €), elle s’inscrit dans un régime répressif qui prévoit des plafonds très élevés (jusqu’à 5 millions d’euros ou 10 % du chiffre d’affaires annuel).
La Cour relève ensuite que les faits à l’origine de la sanction CSSF et de la poursuite pénale sont, à tout le moins, partiellement identiques. Cela lui suffit à caractériser une double poursuite sur le même objet.
Reste alors la question centrale :
Y avait-il une coordination suffisante entre les deux procédures, de nature à rendre le cumul licite ?
La réponse est un NON, clair et documenté.
La Cour souligne :
- L’absence de toute disposition légale imposant un dialogue ou un mécanisme de partage d’informations entre la CSSF et le ministère public ;
- L’absence de synchronisation ou d’articulation entre les deux procédures ;
- L’absence de finalité complémentaire entre les sanctions (elles visent la même entité, les mêmes faits, les mêmes objectifs de dissuasion).
Elle écarte donc la possibilité d’un cumul justifié et conclut à la violation du principe ne bis in idem.
Le couperet tombe : la poursuite pénale jugée irrecevable
La décision est sans appel : Les poursuites pénales sont irrecevables.
La Cour réforme l’ordonnance de renvoi, fait droit à l’exception de procédure soulevée par la défense et met les frais de justice à la charge de l’État.
Le message est clair :
Sans cadre légal de coordination ni justification solide du cumul, le Luxembourg ne peut pas sanctionner deux fois pour les mêmes faits, même dans un domaine aussi sensible que la LCB-FT.
Même l’argument de l’intérêt supérieur de la répression économique ne suffit pas à faire tomber une protection fondamentale consacrée par le droit européen.
La suite ?
Elle s’annonce décisive. Cet arrêt invite à repenser en profondeur l’articulation des pouvoirs répressifs, en particulier dans les régimes à double canal administratif et judiciaire. Et il pourrait bien faire école, ou au contraire inciter à une réforme rapide pour éviter qu’il ne se reproduise.
Une décision qui résonne au-delà des frontières : portée et principes dégagés
Le critère Engel, version luxembourgeoise
Si l’arrêt du 26 février 2025 marque une rupture, c’est avant tout par la clarté avec laquelle la Cour d’appel applique les critères posés par la jurisprudence Engel.
Bien que ces derniers soient bien connus des juristes européens, leur application dans le champ particulier du droit de la régulation bancaire n’allait pas de soi.
En déclarant que la sanction de la CSSF infligée est de nature pénale, la Cour franchit un seuil symbolique : elle reconnaît qu’une autorité de régulation peut, sans le dire expressément, exercer un pouvoir de nature répressive au sens du droit européen.
Le fait que la sanction soit formellement administrative, décidée sans intervention du juge judiciaire, ne fait pas obstacle à sa qualification pénale.
Ce faisant, la Cour réaffirme le principe d’autonomie de la notion de « matière pénale » : ce n’est pas la qualification retenue par le droit national qui importe, mais la réalité du mécanisme répressif.
Ce glissement sémantique et juridique est central : il ouvre la voie à une relecture critique de l’ensemble des régimes de sanction administrative dans le domaine financier, fiscal et prudentiel.
Complémentarité et coordination : les deux piliers absents
Pour être clair, le droit européen n’interdit pas en soi le cumul de sanctions, mais il en encadre strictement les conditions, il est donc nécessaire que soient réunis :
- Un objectif d’intérêt général suffisant pour justifier un cumul (admis en l’espèce) ;
- Une complémentarité réelle entre les sanctions (elles doivent viser des aspects différents du comportement ou des effets distincts) ;
- Une coordination procédurale et temporelle effective (notamment par des mécanismes d’articulation, d’information mutuelle et de proportionnalité globale).
Dans l’affaire, la Cour constate que seule la première condition est remplie : l’objectif de lutte contre le blanchiment est effectivement d’intérêt public majeur. Mais les deux autres sont absentes :
- Il n’y a pas de justification tangible du cumul au regard des effets recherchés ;
- Aucun mécanisme de coordination entre la CSSF et le parquet n’est prévu ni mis en œuvre.
La Cour n’exige donc pas une fusion des procédures, mais au moins une architecture juridique assurant que les deux voies (administrative et pénale) ne se superposent pas de manière arbitraire. C’est cette absence de filet de sécurité procédural qui provoque ici la chute de l’action publique.
Une consécration implicite du rôle juridictionnel du juge du fond
Au-delà de l’application rigoureuse du droit européen, l’arrêt livre un message institutionnel :
Les juridictions nationales doivent assurer elles-mêmes la garantie des droits fondamentaux, même contre la volonté de l’accusation ou en l’absence de disposition nationale claire.
La Cour d’appel s’empare ainsi pleinement de sa fonction de contrôle de conventionnalité in concreto. Elle n’attend pas une réforme législative ni une décision de la CJUE ou de la CEDH pour trancher : elle applique directement les principes issus des traités et de la jurisprudence européenne pour écarter l’action publique.
Cette posture juridictionnelle est à souligner. Elle traduit une maturité du contrôle de proportionnalité exercé par les juridictions nationales, notamment en matière de sanctions multiples. Elle rappelle également que dans un système de double incrimination, c’est souvent le juge national et non le législateur qui agit comme rempart ultime contre l’atteinte aux droits fondamentaux.
En ce sens, l’arrêt du 26 février 2025 dépasse le seul cas d’espèce : il illustre une transformation progressive du juge pénal en juge du dialogue entre droits fondamentaux, régulation financière et efficacité répressive.
Tour d’Europe des modèles : ce que font nos voisins
Une fois n’est pas coutume, il est toujours intéressant de se pencher sur les pratiques voisines, afin de comprendre ce qui pourrait survenir dans un futur proche.
Si l’arrêt du 26 février 2025 a eu l’effet d’un électrochoc au Luxembourg, c’est aussi parce qu’il contraste avec les mécanismes en vigueur dans d’autres États membres de l’Union européenne.
France : l’art du filtrage par l’AMF et le PNF
La France est un exemple intéressant d’État qui a transformé ses pratiques pour tenir compte de la jurisprudence européenne, tout en préservant sa capacité à sanctionner lourdement les manquements financiers.
Le tournant est intervenu avec la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015[1], qui, à propos du cumul entre sanctions de l’AMF et sanctions pénales en matière de délit d’initié, a posé des limites au double filet répressif.
Le principe dégagé : un cumul n’est acceptable que si les sanctions poursuivent des finalités distinctes, sont complémentaires, proportionnées, et que la loi garantit qu’un même fait ne peut pas donner lieu à une répression redondante.
Depuis lors, des protocoles de coopération ont été mis en place entre l’AMF et le parquet national financier (PNF). Concrètement, l’AMF saisit le parquet lorsqu’elle estime que les faits sont suffisamment graves pour relever de la répression pénale, et inversement. Si une procédure est engagée par l’une des deux autorités, l’autre s’abstient généralement d’agir, sauf complémentarité expressément justifiée. Cette coordination est institutionnalisée, documentée, et repose sur un véritable filtre.
La jurisprudence a validé ce système, estimant qu’il respecte les critères de la CEDH et de la CJUE. Résultat : un équilibre relativement stable entre efficacité répressive et respect des garanties fondamentales.
Italie : de Grande Stevens à Menci, l’école de la rigueur procédurale
L’Italie a connu un coup d’arrêt similaire au Luxembourg avec l’arrêt Grande Stevens c. Italie, qui portait sur le cumul entre une sanction de la CONSOB (l’autorité boursière) et une condamnation pénale pour manipulation de marché.
Dans cette affaire, la CEDH avait considéré que la sanction administrative infligée par la CONSOB revêtait un caractère pénal (au sens d’Engel) et que la condamnation pénale subséquente violait le principe ne bis in idem.
En réponse, l’Italie a adapté ses textes et ses procédures. Désormais, un cumul n’est possible que si les procédures sont menées de façon coordonnée, avec des finalités distinctes et une proportionnalité d’ensemble.
L’arrêt Menci de la CJUE, intervenu à propos du cumul de sanctions administratives et pénales en matière de TVA, a confirmé que le cumul restait autorisé dans certaines conditions mais a aussi exigé une architecture procédurale solide.
Depuis, la jurisprudence italienne tend à encadrer strictement les cas de cumul et à privilégier une voie unique de poursuite lorsque les faits sont identiques.
Belgique : sanctions FSMA sous haute surveillance
La Belgique, comme le Luxembourg, s’est retrouvée confrontée aux critiques du Conseil d’État et de la Cour constitutionnelle concernant le régime de cumul entre les sanctions de la FSMA (Autorité des services et marchés financiers) et les poursuites pénales.
Les magistrats ont validé le principe du cumul, mais sous condition de coordination et de proportionnalité. Depuis, les régulateurs belges se sont dotés de procédures internes de filtrage : lorsqu’une sanction administrative est envisagée, elle est précédée d’une concertation avec le parquet pour éviter toute duplication illégitime.
La FSMA et le ministère public disposent également d’un outil de notification mutuelle, permettant de s’assurer qu’un même fait ne fait pas l’objet d’une double poursuite sans justification. Ce système n’est pas encore parfait, mais il montre que la coordination procédurale est devenue une exigence incontournable.
Où se situe le Luxembourg ? Une singularité révélatrice
À la lumière de ces exemples, le Luxembourg apparaît comme une exception notable : une législation silencieuse sur la coordination, une pratique institutionnelle cloisonnée, et une régulation administrative de plus en plus musclée, mais sans garde-fous procéduraux.
L’arrêt du 26 février 2025 met au jour cette anomalie.
Le Grand-Duché n’a pas encore formalisé les instruments permettant d’éviter les chevauchements non contrôlés entre voies administrative et pénale. Cette affaire révèle ainsi un angle mort institutionnel : dans un État fortement exposé aux flux financiers transfrontaliers, la cohérence entre répression et régulation demeure, pour l’heure, lacunaire.
Autrement dit : L’arrêt vient ainsi poser les jalons d’une réforme à venir, que ce soit par voie législative, réglementaire ou par la conclusion de protocoles interinstitutionnels.
Une bouffée d’air pour les droits fondamentaux
L’arrêt du 26 février 2025 ne fait pas que sanctionner une carence procédurale. Il constitue aussi un signal fort, en matière de protection des justiciables contre les abus potentiels du cumul des voies répressives.
Loin d’être une simple victoire procédurale, cette décision apparaît comme une illustration exemplaire du rôle du juge dans la défense des droits fondamentaux dans un système répressif à plusieurs étages.
Le retour en grâce du principe non bis in idem
Depuis plusieurs années, le principe ne bis in idem (nul ne peut être poursuivi ou puni deux fois pour les mêmes faits) avait été mis à mal par une lecture pragmatique de l’efficacité répressive. La jurisprudence européenne elle-même avait infléchi sa position, en admettant un certain cumul sous condition.
L’arrêt luxembourgeois revient à une conception plus exigeante : le respect du principe n’est pas une simple variable d’ajustement de la répression, mais une exigence autonome, invocable et opérante, qui peut conduire à l’irrecevabilité d’une poursuite pénale dès lors qu’un premier volet administratif a déjà sanctionné les mêmes faits.
Le rappel est salutaire : le respect des droits fondamentaux ne saurait être subordonné aux objectifs politiques ou économiques de lutte contre la criminalité financière, aussi impérieux soient-ils.
Une piqûre de rappel pour les autorités de régulation
L’arrêt pose un cadre contraignant, mais utile : les autorités administratives ne peuvent pas prétendre au monopole de la sanction sans s’entourer de garanties, et le parquet ne peut pas ignorer les décisions des régulateurs.
Cette responsabilisation est double :
- Elle impose à la CSSF (et aux régulateurs en général) de prendre conscience que leurs décisions peuvent avoir une nature pénale au sens du droit européen, avec toutes les conséquences que cela implique en termes de garanties, de motivation, et de coordination.
- Elle impose aux autorités de poursuite (parquet, police judiciaire) d’évaluer en amont le risque d’irrecevabilité fondée sur le non bis in idem, et d’organiser leurs relations avec les autorités administratives en conséquence.
Ce mécanisme n’empêche pas toute répression, mais il force les institutions à articuler leurs actions dans le respect des principes fondamentaux, autour d’une valse à deux temps, où chaque pas « répressif » doit s’accorder avec un pas « garant des droits », dans une chorégraphie juridique aussi exigeante qu’essentielle à l’État de droit.
Une invitation à reformer le cadre légal
Si la Cour se borne ici à constater l’absence de coordination procédurale, le message sous-jacent est clair :
Le système juridique luxembourgeois doit évoluer.
L’arrêt agit comme un catalyseur : il révèle une faille dans la régulation pénale des activités économiques et appelle à une réforme institutionnelle.
Cette réforme pourrait prendre plusieurs formes :
- L’introduction d’une obligation de notification mutuelle entre la CSSF (et pourquoi pas, les autres autorités) et le parquet ;
- La mise en place d’un filtre juridictionnel ou d’un mécanisme d’arbitrage entre les procédures ;
- Une définition légale du champ d’application du principe ne bis in idem en matière financière, pour clarifier les conditions du cumul et éviter la censure juridictionnelle.
Le législateur est ainsi renvoyé à ses responsabilités : sans outils de coordination, le système s’expose à l’invalidation répétée des poursuites pénales, ce qui fragilise à la fois la crédibilité des régulateurs et la confiance dans l’arsenal répressif.
Un revers pour l’efficacité répressive ?
Si l’arrêt du 26 février 2025 marque un progrès certain en matière de protection des droits fondamentaux, il n’est pas exempt de critiques.
Plusieurs observateurs y verront une décision excessivement formaliste, qui affaiblit la répression financière dans un contexte international où la tolérance zéro contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est une exigence politique et diplomatique.
Le risque d’un angle mort répressif en matière LCB-FT
En l’état actuel du droit luxembourgeois, l’absence de coordination entre la CSSF et le ministère public n’est pas une anomalie ponctuelle, mais une réalité institutionnelle. Autrement dit, chaque fois que la CSSF inflige une sanction « pénale » au sens des critères Engel, ce qui est de plus en plus fréquent, elle neutralise potentiellement toute poursuite pénale ultérieure sur les mêmes faits.
Le résultat ?
Un paradoxe : les établissements fautifs pourraient stratégiquement préférer se faire sanctionner rapidement par la CSSF (procédure souvent moins intrusive et plus technique), pour échapper ensuite à des poursuites pénales plus lourdes et symboliquement plus stigmatisantes. Cela revient, in fine, à organiser une forme d’auto-amnistie de fait par la régulation.
Dans les cas les plus graves (complicité de blanchiment, manquements systémiques dans des affaires de criminalité transnationale), cette situation crée un angle mort préoccupant pour la justice pénale. La lutte contre le blanchiment devient un enjeu à géométrie variable, dépendant moins de la gravité des faits que du calendrier des autorités.
Un frein potentiel à la lutte contre les délinquants en col blanc
Au-delà du cas d’espèce, l’arrêt pourrait inciter les autorités de poursuite à renoncer à certains dossiers, par crainte d’une irrecevabilité fondée sur le non bis in idem. Cette prudence institutionnelle pourrait se transformer en inertie. Or, les infractions économiques les plus complexes nécessitent souvent des investigations longues, des actes d’instruction invasifs, et un recours à des sanctions exemplaires.
En évacuant trop rapidement la voie pénale au profit d’une sanction administrative plus souple, on risque :
- D’affaiblir la portée dissuasive du système ;
- De priver le juge pénal de sa capacité à prononcer des peines complémentaires (exclusion d’une activité, confiscation, publication, interdiction d’exercer) ;
- D’entretenir l’image d’un droit pénal économique de seconde zone, réservé aux manquements les moins sensibles.
Certes, l’exigence de proportionnalité et de respect des droits fondamentaux doit être préservée, mais elle ne peut pas devenir un bouclier absolu contre toute réponse judiciaire structurée.
Quand la forme prime sur le fond : débat sur la proportionnalité
Une autre critique, plus juridique, tient à la hiérarchie implicite que crée l’arrêt entre l’action administrative et l’action pénale. En considérant que la première « bloque » la seconde, la Cour fait de la CSSF une sorte de juridiction de fait, capable d’anéantir toute poursuite ultérieure. Ce raisonnement peut paraître excessivement formaliste.
En effet, on peut estimer que :
- La sanction de la CSSF est, malgré son montant, d’une portée limitée : pas de stigmatisation morale, pas de procédure contradictoire équivalente à celle du juge pénal, pas de publicité systématique ;
- La poursuite pénale aurait pu poursuivre des objectifs différents : par exemple, la mise en cause de dirigeants spécifiques, la recherche de responsabilité individuelle, ou la réparation des dommages à l’ordre public économique ;
- Une interprétation plus souple du principe ne bis in idem aurait permis d’accepter le cumul dès lors que les deux procédures visaient des effets différents, même partiellement.
En d’autres termes, le souci de protection des droits fondamentaux, bien que louable, ne doit pas conduire à un excès de frilosité procédurale, au risque d’entraver la capacité de l’État à punir effectivement les atteintes graves à l’ordre public économique.
Ce que l’on ne s’attendait pas à lire : les surprises de l’arrêt
Si l’arrêt du 26 février 2025 est solide d’un point de vue juridique, il n’en reste pas moins, à certains égards, déconcertant. Par-delà son raisonnement rigoureux, la décision fait émerger plusieurs lignes de tension doctrinale qui pourraient déconcerter les praticiens. Entre glissements conceptuels et audaces interprétatives, voici les points qui, en creux, interpellent.
La CSSF assimilée à une autorité quasi-pénale ?
L’un des points les plus inattendus de l’arrêt réside dans la manière dont la Cour qualifie la CSSF : non plus seulement comme un régulateur administratif, mais comme une entité susceptible d’infliger des sanctions de nature pénale.
Ce basculement sémantique n’est pas anodin : il change radicalement la manière dont on doit envisager l’action disciplinaire de l’autorité de surveillance.
Autrement dit, le système de sanctions financières instauré par la CSSF ne relève plus exclusivement du droit administratif, mais empiète sur le champ du droit pénal substantiel et procédural.
Ce constat oblige à poser une question qui dérange : la CSSF, dans sa configuration actuelle, est-elle juridiquement outillée pour exercer une fonction pénale de fait ? Quid des autres autorités ?
- Leurs procédures garantissent-elles l’égalité des armes ?
- Leur indépendance vis-à-vis de l’exécutif est-elle équivalente à celle d’une juridiction ?
- Les voies de recours qu’elle prévoit suffisent-elles à garantir les droits de la défense ?
Si la réponse est non à l’une de ces questions, alors c’est toute la légitimité du régime de sanction administrative luxembourgeois qu’il faut repenser. Ce n’est pas seulement le parquet qu’on neutralise par cette jurisprudence : c’est aussi, indirectement, la CSSF et les autres autorités par ricochet qu’on oblige à changer de statut ou de fonctionnement.
L’identité de faits : une appréciation extensive du principe de non bis in idem
Autre surprise : la manière dont la Cour d’appel interprète l’identité de faits entre la procédure administrative et la procédure pénale. Elle considère que les faits visés par les deux procédures sont « à tout le moins partiellement identiques », et que cela suffit à faire obstacle à la poursuite.
Cette appréciation très large rompt avec une tendance plus stricte, selon laquelle le non bis in idem ne joue que si les faits, les personnes et la qualification juridique sont identiques ou quasi identiques.
Ici, la Cour retient une approche plus souple, privilégiant une lecture matérielle des faits.
Ce choix peut paraître discutable : on aurait pu considérer que les sanctions de la CSSF visent le système de contrôle interne de l’établissement, tandis que la procédure pénale vise des comportements individuels précis (ex. : absence de déclaration de soupçon, défaut d’analyse).
La fusion des objets procéduraux, sans démonstration fine de leur identité réelle, affaiblit potentiellement la portée de la répression pénale en élargissant indéfiniment la zone d’exclusion du cumul.
Une décision protectrice, mais peut-être trop rigide
Enfin, ce qui surprend, c’est le refus, par la Cour, de se livrer à une appréciation in concreto de la complémentarité des sanctions.
Elle aurait pu adopter une position nuancée : reconnaître la nature pénale de la sanction CSSF, constater une certaine identité de faits, mais considérer que le cumul est néanmoins justifié car les procédures sont menées à des moments différents, visent des finalités complémentaires et aboutissent à des effets distincts.
Ce que fait la Cour, en revanche, c’est une application littérale et rigide du triptyque exigé par la jurisprudence européenne : elle exige une articulation visible, explicite et cohérente des deux procédures.
Cette exigence de formalisation absolue surprend d’autant plus qu’elle laisse peu de marge d’appréciation aux autorités, y compris en présence d’un intérêt général manifeste à poursuivre pénalement certains faits.
Autrement dit, l’arrêt défend une lecture maximaliste du principe ne bis in idem, au détriment peut-être d’une logique plus téléologique, qui viserait à équilibrer efficacité répressive et protection des droits fondamentaux.
Que faire demain ? Repenser le couple régulateur/parquet
L’arrêt du 26 février 2025 agit comme un révélateur. Il ne se contente pas de sanctionner une irrégularité procédurale : il met à nu une défaillance structurelle dans l’architecture institutionnelle luxembourgeoise en matière de répression des manquements LCB-FT.
Si les autorités administratives peuvent infliger des sanctions à caractère pénal, alors le système doit impérativement organiser leur articulation avec l’action publique judiciaire.
À défaut, il s’expose à l’invalidation systématique des poursuites.
Des mécanismes de coordination à formaliser
La première urgence est institutionnelle : Un cadre formel de coordination entre les régulateurs sectoriels (CSSF, CAA…) et le ministère public pourrait être créé. Ce cadre pourrait comprendre plusieurs outils complémentaires :
- L’instauration d’une obligation légale de notification mutuelle entre les autorités et le parquet : dès qu’une procédure administrative est ouverte sur des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale, le ministère public doit être informé (et inversement).
- La mise en place d’un registre commun des procédures répressives (administratives ou judiciaires) en matière LCB-FT, accessible à toutes les autorités compétentes, permettant de prévenir les doubles poursuites non concertées.
- La désignation d’un point de contact dédié dans chaque autorité, chargé d’assurer la liaison entre régulateurs et parquet, selon des modalités encadrées.
Ces mesures ne visent pas à fusionner les voies répressives, mais à assurer une visibilité réciproque sur les procédures en cours. Elles constitueraient une première ligne de défense contre les violations du principe ne bis in idem.
Vers un principe de subsidiarité entre sanctions ?
Au-delà de la coordination, il est temps de réfléchir à une hiérarchisation fonctionnelle entre les voies répressives. L’une des options envisageables serait d’instaurer un principe de subsidiarité : si la sanction administrative permet de rétablir l’ordre public économique et présente un caractère suffisamment dissuasif, la voie pénale pourrait s’effacer, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce principe pourrait être formulé ainsi :
- En cas de manquement technique ou ponctuel, les autorités conservent la main, dans une logique de régulation et de pédagogie ;
- En cas de manquement systémique, intentionnel, ou impliquant une dimension interpersonnelle (responsabilité de dirigeants, complicité, dissimulation), la priorité revient au parquet ;
- En cas de doute, une procédure de concertation obligatoire doit être déclenchée.
Un tel dispositif garantirait une utilisation ciblée de la voie pénale, tout en évitant l’effet « coupe-circuit » qu’induit aujourd’hui l’intervention prioritaire du régulateur.
Une idée à creuser : un filtre juridictionnel préalable au cumul
Pour sécuriser les cumuls de sanctions, une autre option, plus ambitieuse, consisterait à instaurer un filtre juridictionnel. Avant qu’un parquet puisse engager des poursuites sur des faits déjà sanctionnés administrativement (ou inversement), une juridiction indépendante (par exemple la chambre du conseil ou un magistrat de liaison spécialisé) serait saisie pour :
- Vérifier l’identité des faits ;
- Apprécier la complémentarité des finalités ;
- Évaluer la proportionnalité de l’ensemble des sanctions envisagées.
Ce « visa juridictionnel » ne bloquerait pas l’action du parquet, mais garantirait en amont le respect des exigences européennes, tout en sécurisant juridiquement les procédures. Il serait aussi un outil d’harmonisation des pratiques.
Plusieurs pays ont déjà expérimenté des mécanismes similaires, le Luxembourg pourrait s’en inspirer pour concilier rigueur procédurale et efficacité répressive.
Conclusion : Un arrêt-charnière à suivre de près
Une victoire de principe aux effets pratiques contestables
L’arrêt de la Cour d’appel du 26 février 2025 constitue une décision forte, lucide et juridiquement fondée.
Il rappelle avec fermeté que la protection des droits fondamentaux n’est pas une option, même face aux impératifs de lutte contre la criminalité financière. En appliquant avec rigueur les critères de la jurisprudence européenne, la Cour dégage une ligne claire : toute sanction administrative à caractère pénal doit, pour coexister avec une sanction pénale, s’inscrire dans un système coordonné, proportionné et justifié.
Mais cette victoire de principe pose un paradoxe : en invalidant la poursuite pénale sans offrir d’alternative répressive équivalente, la décision fragilise, de fait, la capacité du ministère public à agir. Ce désarmement procédural juridiquement inévitable en l’état actuel du droit luxembourgeois, soulève des interrogations légitimes sur l’efficacité globale de la réponse institutionnelle face aux manquements graves à la LCB-FT.
Une jurisprudence qui pourrait inspirer, ou inquiéter
Par sa portée, l’arrêt pourrait servir de référence dans d’autres juridictions confrontées à des mécanismes de double poursuite.
Il met en lumière les failles systémiques que toute démocratie avancée doit aujourd’hui affronter :
- Comment concilier l’efficacité des sanctions avec la rigueur procédurale exigée par la CEDH et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?
- Comment construire des dispositifs hybrides qui garantissent à la fois la répression des comportements fautifs et le respect des droits procéduraux des personnes poursuivies ?
Mais cette jurisprudence peut également inquiéter : si elle venait à s’appliquer de manière extensive, elle pourrait paralyser les efforts de lutte contre les délits économiques complexes, où les régulateurs et les procureurs agissent parfois en parallèle, par nécessité.
Un test pour le législateur : combler le vide, ou changer de paradigme ?
La balle est désormais dans le camp du législateur luxembourgeois.
L’arrêt ne dit pas qu’il est interdit de cumuler les sanctions ; il dit que ce cumul ne peut pas s’improviser. Pour être juridiquement valable, il doit être organisé, articulé et encadré. Autrement dit, c’est l’absence de mécanisme et pas le cumul lui-même qui est sanctionnée.
Le choix politique est donc clair : Soit l’on accepte de renoncer au cumul et de repenser les voies de la répression financière selon un modèle unique, clair et exclusif (régulation ou pénal) ; soit l’on maintient la logique du double filet, mais en la dotant d’une architecture formelle, interinstitutionnelle et juridiquement solide.
Dans les deux cas, le statu quo n’est plus tenable.
Conclusion générale
L’arrêt du 26 février 2025 restera probablement comme une jurisprudence de rupture.
Par la finesse de son raisonnement comme par la portée de ses implications, il invite à un aggiornamento du droit répressif économique luxembourgeois.
Il appelle à sortir d’une culture du cloisonnement institutionnel pour entrer dans une logique de coopération encadrée entre les régulateurs et les autorités judiciaires.
Cette transition ne sera pas simple : elle exigera un effort de clarification normative, d’ouverture culturelle entre institutions, et une révision profonde des pratiques.
Mais elle est aussi une opportunité : celle de construire un modèle de répression financière moderne, cohérent, respectueux des droits fondamentaux et capable de répondre, efficacement, aux défis d’une criminalité économique toujours plus sophistiquée tout en impliquant les assujettis sur un terrain clair, porté par le bon sens et la volonté de tous d’agir dans un intérêt commun : celui de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.