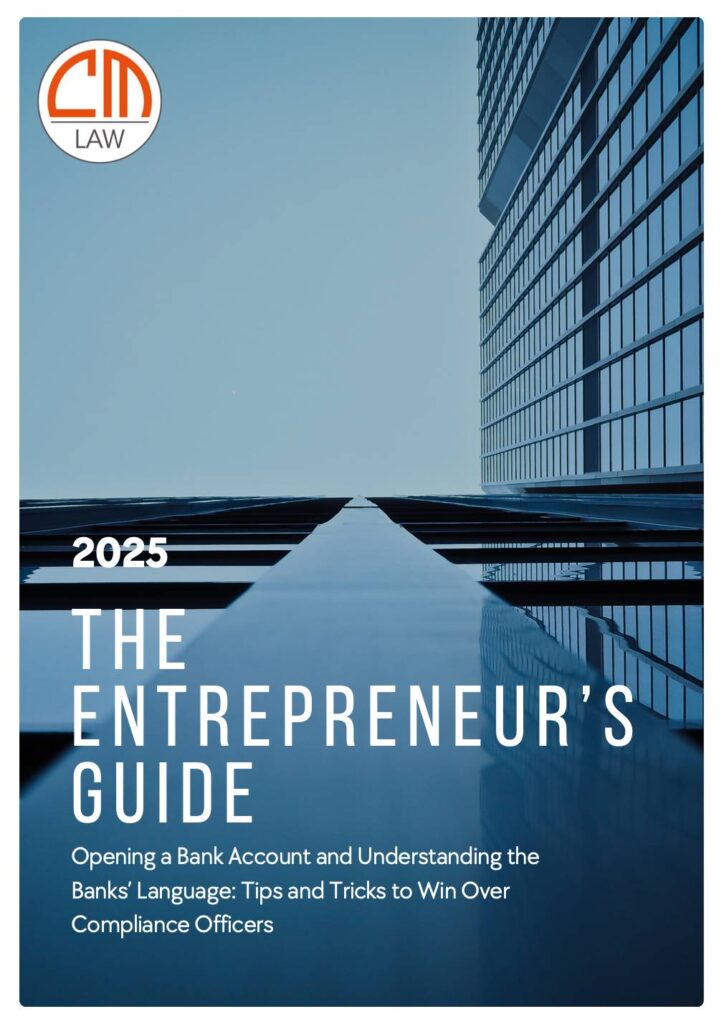« Toute personne qui, à titre permanent ou temporaire, collecte, analyse, transmet ou exploite des informations d’intérêt pour la sécurité nationale ou publique, pour le compte d’un État ou d’une organisation autorisée. »
Avouez-le : cela ressemble étrangement à la fiche de poste d’un compliance officer moderne.
Chaque jour, dans les banques, fonds, études et fiduciaires, les équipes conformité collectent des données financières et personnelles, décortiquent des comportements, tracent des opérations, et transmettent le tout aux autorités. Leur mission : repérer les anomalies, identifier les risques, et, si nécessaire, alimenter la CRF.
Et pourtant… ce n’est pas la définition d’un compliance officer.
C’est celle d’un agent du renseignement, telle qu’adoptée par l’OTAN et l’Union européenne.
On nous l’a longtemps vendu comme un outil de transparence et de confiance : la compliance protège le client, le marché, l’économie.
La réalité est tout autre. Les assujettis à la loi AML ne protègent pas leurs clients. Ils protègent l’ordre public.
Les obligations de vigilance et de déclaration leur imposent de collecter, analyser et, le cas échéant, signaler toute information sensible à la CRF, sans prévenir le client ni obtenir son consentement.
En clair : le législateur a transformé ces professionnels en antennes de l’État, chargées de nourrir la chaîne de renseignement financier.
Mais, contrairement aux agents officiels, ils assument ce rôle sans statut, sans formation publique et sans indemnité.
Cette mission ne se limite pas à cocher des cases réglementaires. Elle engage la responsabilité civile et pénale de chaque assujetti, y compris du compliance officer.
La jurisprudence luxembourgeoise, avec l’arrêt de la cour de cassation 175/2024 du 28 novembre 2024, l’a rappelé : l’inaction peut être assimilée à une intention coupable, même si le professionnel n’a pas directement exécuté l’opération. Le simple fait de ne pas avoir agi, de ne pas avoir déclaré, alors qu’il avait l’obligation et la capacité de le faire, peut suffire à engager sa responsabilité.
En France, si aucun compliance officer n’a encore été condamné à ce jour pour complicité en matière de blanchiment, la jurisprudence sur l’abstention coupable et la complicité par omission existe bel et bien. Les professionnels qui détiennent des informations permettant de prévenir une infraction et qui restent inactifs peuvent voir leur responsabilité pénale retenue – comme ce fut le cas dans certaines affaires impliquant des experts-comptables ou commissaires aux comptes, condamnés pour complicité de blanchiment ou d’escroquerie.
Autrement dit : ne rien faire, c’est parfois participer.
Comme si la mission AML n’était pas déjà assez lourde, les autorités ont franchient un nouveau cap : ils invitent les professionnels assujettis à repérer des signes de radicalisation chez leurs clients.
Dans son document « Tendances et analyses 2018-2019 », TRACFIN cite un cas pratique dans lequel les critères d’alerte à relever par le déclarant dans le cadre de soupçons de financement du terrorisme incluent notamment un changement marqué d’apparence physique, ou encore conversion religieuse rapide et/ou démonstrative.
De son côté, l’ACPR, dans une décision de sanction du 22 mars 2018 visant un établissement de crédit, évoque-t-elle aussi à plusieurs reprises des « signaux faibles » liés aux comportements ou à la tenue vestimentaire de clients. Elle précise que ces éléments doivent être détectés par le personnel en agence, notamment lorsque le changement de tenue d’un client peut être interprété comme un indice de radicalisation.
En filigrane, ces exemples montrent bien que les assujettis – et particulièrement leurs équipes en contact direct avec le public – sont invités, de facto, à détecter des signes de radicalisation idéologique ou religieuse, un rôle qui dépasse largement la compétence purement financière ou réglementaire de la compliance.
Mais qui, parmi les compliance officers, a été formé pour cela ?
Personne. Et pourtant, on leur demande désormais de devenir psychologues, sociologues et analystes comportementaux, sans cadre, sans protection et sans garde-fou contre les biais culturels, sociaux ou politiques.
Un pas de plus vers une confusion des genres qui, tôt ou tard, exposera ces professionnels à des accusations d’erreur, de discrimination, ou pire : de complicité par défaut.
Les assujettis AML sont aujourd’hui à la croisée des chemins :
- Analystes financiers quand il s’agit d’évaluer les flux et les risques ;
- Enquêteurs lorsqu’ils remontent les chaînes d’opérations ;
- Lanceurs d’alerte quand ils transmettent à la CRF ;
- Et maintenant, détecteurs de signaux sociaux supposés anticiper la radicalisation.
Tout cela sous menace de sanctions civiles et pénales, mais sans statut, sans formation adéquate, sans reconnaissance officielle.
Personne ne conteste l’utilité de ce dispositif. La lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et les crimes financiers est essentielle.
Mais la question est : jusqu’où peut-on déléguer des missions de sécurité publique à des acteurs privés, sans cadre, sans contrepartie et sans protection ?